

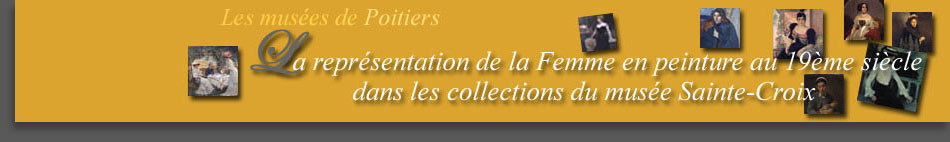

Première évidence : être c’est exister, donc avoir une réalité tangible. Mais sitôt que le verbe se pare d’attributs, le champ d’investigation s’enrichit de données complémentaires, se ramifie en pistes interprétatives auxquelles la production d’œuvre d’art fait implicitement allusion.
Être induit une qualification, une appartenance, une identité (elle est une femme, elle est jeune, elle est une épouse), un état (elle est gaie, elle est pensive), un lieu (elle est dans son jardin ou dans son salon), une provenance spatiotemporelle (elle est de la campagne, elle est du 19ème siècle).
Mais être définit aussi une forme particulière d’inclusion : être de cette communauté féminine, en faire partie, et peut-être même ne pas pouvoir s’en extraire.
Enfin, le verbe détermine, à l’occasion, une identité en négatif, dessine en creux un statut caractérisé par le manque : être sans ressources, sans autonomie, sans pouvoir.
Plus équivoque, paraître balance entre deux grandes orientations de lecture : de la notion de visibilité, jusqu’à l’ambiguïté d’une « imposture » soupçonnée, chez celui qui afficherait une apparence trompeuse.
Mais, à l’intérieur même de la notion de visibilité, laisser paraître est bien différent d’aimer paraître : dans le premier cas, on montre, on manifeste – un tempérament, une émotion – , y compris contre son gré ; tandis que dans le second cas, on se produit, voire on se met en scène dans le but d’y briller.
Plus subtile encore, l’apparence se joue parfois des réalités, investit la sphère de l’identité pour en complexifier l’appréhension. Soudain, l’être et le paraître se confrontent : peut-on avoir l’air riche et respectable sans l’être réellement ? Est-on vraiment heureux si l’on paraît heureux ? Sous la liberté offerte par l’art de l’apparence pointe aussi l’idée de la contrainte, de l’obligation de paraître, liée à un rang, un statut, un devoir de se conformer aux attentes du « groupe social ».
À partir de la Révolution française, la classe dominante est cette bourgeoisie dont la puissance avait commencé à poindre sous l’aristocratie déclinante de la fin du 18ème siècle. Cette ascension traduit un véritable renversement des valeurs, qui assurent maintenant le pouvoir à la fortune comme elles l’assuraient auparavant au rang et à la naissance.
Soucieuse de ses intérêts, la bourgeoisie affairiste prône les vertus d’une économie libérale qui favorise la course à l’enrichissement personnel. Dans ce contexte d’âpre concurrence et de compétitivité, la solitude menace la classe dirigeante, d’autant que la montée de l’individualisme relâche les liens sociaux. Ce risque d’isolement, joint au poids du pouvoir et des responsabilités dont les hommes se sont investis, a pour conséquence la consécration de la cellule familiale, du « foyer-remède », au sein duquel la femme va assumer un rôle quasi sacré. Âme de la maisonnée, inspirant considération et respect, elle dispense équitablement soins, amour et attentions, créant un refuge accueillant et fiable et parant en outre ce confort de sa grâce et de sa beauté.
Lorsqu’elle quitte les murs domestiques, la femme vaque à ses œuvres de bienfaisance ou à ses obligations mondaines : bals, réceptions, spectacles, salons, sont autant d’occasions de paraître, et les épouses y sont en constante représentation, chargées d’exprimer par leur toilette la position sociale de leur mari. En effet, depuis que les hommes ont renoncé pour eux-mêmes aux fards, aux parfums, à l’ostentation vestimentaire, pour adopter la respectable neutralité du vêtement sombre, ils ont délégué à leurs épouses le soin d’exhiber les richesses acquises.
Cette tendance à investir le corps de la femme d’une fonction de parade sociale trouve sa meilleure illustration picturale dans le portrait. Mais elle s’inscrit aussi dans un mouvement plus général qui associe l’image féminine à un certain nombre de valeurs – beauté, douceur, sensibilité. Cette idéologie d’une division binaire entre compétences masculines et féminines est tellement ancrée dans les esprits comme un postulat inattaquable, que les peintres s’en font naturellement les illustrateurs. Parce que toute production artistique s’inscrit obligatoirement dans un contexte, dans un courant d’idées, les peintres de la femme traduisent en majorité l’opinion générale, ou y font implicitement référence.