Charles-Louis MÜLLER --- « La fête de la Raison dans Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793 »





Analyse iconographique
- Poussé par un souci de restitution historique, l'artiste a soigné son décor, mais resserre malgré tout la scène sur le sujet majeur de cette vaste farandole populaire : le cortège hissant la personnification de la déesse Raison.
- En conséquence, toute l'importance est donnée au premier plan, qui déborde presque le cadre grâce à un procédé "d'entassement" des personnages, qui dilate la scène en largeur.
- La dynamique des différents groupes est complétée par l'axe oblique du pavois, qui oblige d'ailleurs la jeune femme, emportée par un irrésistible mouvement, à opérer une franche rotation du buste pour rétablir le contact avec le spectateur.
- De nombreuses lignes hérissent cette scène. La composition est basée sur le premier plan qui incite le spectateur à s’identifier aux personnages représentés à taille réelle. Puis, on nous guide vers le drapeau à gauche, et du drapeau vers le fanion. De là, on peut s’intéresser au personnage principal qui nous regarde en souriant et en foulant du pied droit un crucifix.
- La femme est à droite de la médiane verticale, le pilier derrière elle, renforce sa présence. Sa main gauche s’appuie sur la médiane horizontale. Le rabat de a largeur sur la longueur place à gauche le temple, à droite, le pilier. Un point de fuite se situe loin à droite, hors du tableau, à la hauteur des visages du 1er plan.
- C’est l’allégorie de la débauche : on foule du pied les symboles religieux dans une mise en scène animée (enfumoir, temple, chorale, vêtements particuliers). Il est entendu que le propos de l’artiste n’est pas celui de la jeune femme en gloire au centre du tableau, Müller critique cette fête qu’il cite par un titre très précis.
- Plusieurs personnages sont là pour évoquer la Révolution par les bonnets, écharpes, rubans, plumes, drapeaux. La femme de mauvaise vie est qualifiée par la couleur (rose), le regard aguicheur, les bottines rouges, le vêtement entrouvert laissant voir les bas, l’alcool (une bouteille est brandie à gauche, dans la foule), et le geste outrageant (pied sur le crucifix). L’artiste joue d’ironie en asseyant cette jeune femme sur un fauteuil garni de feuilles de chêne (deux symboles du pouvoir, de la gloire).

 Quoi en penser ? Sans s'aventurer sur le terrain explicite de l'allégorie, Charles-Louis Müller semble néanmoins animé d'une démarche pédagogique, idéologique et moralisante. Le peintre a tiré partie d'une documentation nourrie pour réaliser son tableau. Selon plusieurs chroniques du temps, c'est une actrice de l'Opéra qui avait tenu le rôle de la nouvelle divinité, dont le culte avait été officiellement institué. Mais Müller a clairement sélectionné ses sources d'information, en adhérant aux propos des contre-révolutionnaires, qui ne voyaient dans cette cérémonie de 1793 qu'une fureur iconoclaste et populaire, élevant au rang suprême une prostituée dûment rétribuée. Ainsi, il retourne à son profit la volonté didactique de l'époque révolutionnaire qui avait beaucoup investi la figure féminine des vertus de sagesse, de pureté, d'abondance. Sous le pinceau du peintre, la jaune femme accuse une physionomie avenante mais sans distinction, le regard aguicheur, un sourire d'invite aux lèvres. La trivialité de l'attitude - main gauche empoignant l'accoudoir avec la force d'un poing fiché au creux de la taille - n'allège pas le propos. Sans doute son visage est-il plus calme que le sfaces avinées et braillardes qui lui font cortège. Mais l'artiste souligne que la jeune femme est à la tête de cette assemblée en liesse, ce qui ne semble pas constituer une promotion valorisante. Vêtue dans des tons de roses et de rouges (sorte d'antithèse au vêtement marial), cette figure féminine incarne l'idée de débauche et de luxure dont l'artsiste souhaite créditer les concepteurs de cette célébration révolutionnaire.
Quoi en penser ? Sans s'aventurer sur le terrain explicite de l'allégorie, Charles-Louis Müller semble néanmoins animé d'une démarche pédagogique, idéologique et moralisante. Le peintre a tiré partie d'une documentation nourrie pour réaliser son tableau. Selon plusieurs chroniques du temps, c'est une actrice de l'Opéra qui avait tenu le rôle de la nouvelle divinité, dont le culte avait été officiellement institué. Mais Müller a clairement sélectionné ses sources d'information, en adhérant aux propos des contre-révolutionnaires, qui ne voyaient dans cette cérémonie de 1793 qu'une fureur iconoclaste et populaire, élevant au rang suprême une prostituée dûment rétribuée. Ainsi, il retourne à son profit la volonté didactique de l'époque révolutionnaire qui avait beaucoup investi la figure féminine des vertus de sagesse, de pureté, d'abondance. Sous le pinceau du peintre, la jaune femme accuse une physionomie avenante mais sans distinction, le regard aguicheur, un sourire d'invite aux lèvres. La trivialité de l'attitude - main gauche empoignant l'accoudoir avec la force d'un poing fiché au creux de la taille - n'allège pas le propos. Sans doute son visage est-il plus calme que le sfaces avinées et braillardes qui lui font cortège. Mais l'artiste souligne que la jeune femme est à la tête de cette assemblée en liesse, ce qui ne semble pas constituer une promotion valorisante. Vêtue dans des tons de roses et de rouges (sorte d'antithèse au vêtement marial), cette figure féminine incarne l'idée de débauche et de luxure dont l'artsiste souhaite créditer les concepteurs de cette célébration révolutionnaire.


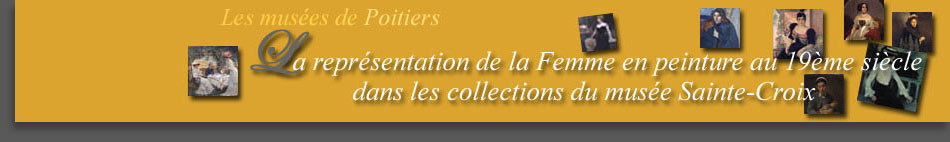




 Quoi en penser ? Sans s'aventurer sur le terrain explicite de l'allégorie, Charles-Louis Müller semble néanmoins animé d'une démarche pédagogique, idéologique et moralisante. Le peintre a tiré partie d'une documentation nourrie pour réaliser son tableau. Selon plusieurs chroniques du temps, c'est une actrice de l'Opéra qui avait tenu le rôle de la nouvelle divinité, dont le culte avait été officiellement institué. Mais Müller a clairement sélectionné ses sources d'information, en adhérant aux propos des contre-révolutionnaires, qui ne voyaient dans cette cérémonie de 1793 qu'une fureur iconoclaste et populaire, élevant au rang suprême une prostituée dûment rétribuée. Ainsi, il retourne à son profit la volonté didactique de l'époque révolutionnaire qui avait beaucoup investi la figure féminine des vertus de sagesse, de pureté, d'abondance. Sous le pinceau du peintre, la jaune femme accuse une physionomie avenante mais sans distinction, le regard aguicheur, un sourire d'invite aux lèvres. La trivialité de l'attitude - main gauche empoignant l'accoudoir avec la force d'un poing fiché au creux de la taille - n'allège pas le propos. Sans doute son visage est-il plus calme que le sfaces avinées et braillardes qui lui font cortège. Mais l'artiste souligne que la jeune femme est à la tête de cette assemblée en liesse, ce qui ne semble pas constituer une promotion valorisante. Vêtue dans des tons de roses et de rouges (sorte d'antithèse au vêtement marial), cette figure féminine incarne l'idée de débauche et de luxure dont l'artsiste souhaite créditer les concepteurs de cette célébration révolutionnaire.
Quoi en penser ? Sans s'aventurer sur le terrain explicite de l'allégorie, Charles-Louis Müller semble néanmoins animé d'une démarche pédagogique, idéologique et moralisante. Le peintre a tiré partie d'une documentation nourrie pour réaliser son tableau. Selon plusieurs chroniques du temps, c'est une actrice de l'Opéra qui avait tenu le rôle de la nouvelle divinité, dont le culte avait été officiellement institué. Mais Müller a clairement sélectionné ses sources d'information, en adhérant aux propos des contre-révolutionnaires, qui ne voyaient dans cette cérémonie de 1793 qu'une fureur iconoclaste et populaire, élevant au rang suprême une prostituée dûment rétribuée. Ainsi, il retourne à son profit la volonté didactique de l'époque révolutionnaire qui avait beaucoup investi la figure féminine des vertus de sagesse, de pureté, d'abondance. Sous le pinceau du peintre, la jaune femme accuse une physionomie avenante mais sans distinction, le regard aguicheur, un sourire d'invite aux lèvres. La trivialité de l'attitude - main gauche empoignant l'accoudoir avec la force d'un poing fiché au creux de la taille - n'allège pas le propos. Sans doute son visage est-il plus calme que le sfaces avinées et braillardes qui lui font cortège. Mais l'artiste souligne que la jeune femme est à la tête de cette assemblée en liesse, ce qui ne semble pas constituer une promotion valorisante. Vêtue dans des tons de roses et de rouges (sorte d'antithèse au vêtement marial), cette figure féminine incarne l'idée de débauche et de luxure dont l'artsiste souhaite créditer les concepteurs de cette célébration révolutionnaire.