Raoul CARRE --- « Le thé en famille »





Analyse iconographique
- Sur un fond paysagé assez enlevé, le peintre a composé un portrait de groupe qui s’apparente à une scène d’intérieur, tant les feuillages serrés de la charmille recréent autour des personnages les conditions d’une pièce intime et accueillante.
- L’artiste utilise un quadrillage avec une partition par quart à l’horizontale comme à la verticale. Les deux médianes placent la théière. Le premier quart horizontal en bas donne l’assise des chaises. Le dernier quart horizontal en haut donne la ligne des yeux du personnage principal en train de servir le thé.
- Verticalement, dans le quart de gauche, on a la grand-mère, le quart suivant contient le grand-père et son petit-fils sur ses genoux, le troisième quart place la mère de l’enfant, et le dernier quart de droite est occupé par la chaise vide de la mère qui vient de se lever. Ce quadrillage est repris à l’arrière-plan mais de façon décalée par la pergola.
- Quelques fuyantes (chaises, couteau, ellipse de la table) très courtes donnent de la profondeur mais il est difficile de placer avec précision un point de fuite ; on peut dire néanmoins qu’il se situe autour de la médiane verticale à la hauteur des yeux des personnages assis, c’est à dire juste au-dessus de la théière.
- La composition est très subtilement décalée vers la gauche, grâce à la jeune femme debout, qui est le véritable pivot de la scène, sans pour autant en marquer le centre. Sa silhouette gracieuse, épanouie en forme de corolle inversée, lui confère une ligne élégante, florale, qui s'oppose au statisme des autres personnages. Les robes et les mouvements des femmes placent des obliques en losange. Curieusement, le motif du losange est aussi celui de la nappe, pratiquement sur la médiane verticale.
- Plusieurs éléments désignent le jardin : la pergola, les sièges en osier, la table aux pieds métalliques, les motifs simples de la nappe. Les personnages sont bien habillés, nous sommes face à une famille aisée : dentelles, voiles, chapeaux fleuris, cravate. Sur la table, on peut voir un service à thé fleuri, des flûtes de champagne, une bouteille, des serviettes, des couverts. C’est le milieu de l’après-midi, on prend le thé dehors comme on peut le faire en été ou au printemps.
- On pourrait croire que Carré veut nous montrer le grand-père et son petit-fils puisqu’il les encadre par les deux femmes, il les place aussi sur un fond clair, et enfin il se sert de la pergola pour recadrer ce couple masculin. Mais finalement c’est la mère qui est le sujet du tableau : elle est la seule debout, la seule en mouvement, sa robe forme une grande courbe souple qui s’oppose à l’attitude statique voire sévère (elle nous regarde impassible) de la grand-mère.
- Chaque âge de la vie a sa place, son attitude, sa fonction, dans la famille comme sur le tableau.

 Quoi en penser ? Ce petit portrait de groupe permet à chacun d'assumer ses responsabilités d'ordre familial : l'effacement pour le viel homme et le garçonnet, unis dans le même mouvement d'affection, et qui reconnaissent par leur retrait que les femmes règnent en maîtresse dans l'aire domestique ; l'allure irréprochable pour la femme assise - mère ou belle-mère ayant gagné avec le temps un statut influent ; l'attitude respectueuse pour la jeune femme, qui se plie de bonne grâce au service du thé, ainsi qu'à son devoir, plus implicite, d'être décorative. A chaque âge de la vie d'une femme son rôle et ses devoirs : la maturité offre l'avantage d'une respectabilité accrûe, d'un surplus d'autorité, mais exige en retour un comportement digne jusqu'à l'asutérité ; la jeunesse souscrit à des obligations de séduction, d'élégance, mais se doit aussi d'adopter un maintien docile et modeste.Ce rituel du thé forge ainsi l'occasion d'un cérémonial fédérateur, garant d'entente, d'ordre et de tradition.
Quoi en penser ? Ce petit portrait de groupe permet à chacun d'assumer ses responsabilités d'ordre familial : l'effacement pour le viel homme et le garçonnet, unis dans le même mouvement d'affection, et qui reconnaissent par leur retrait que les femmes règnent en maîtresse dans l'aire domestique ; l'allure irréprochable pour la femme assise - mère ou belle-mère ayant gagné avec le temps un statut influent ; l'attitude respectueuse pour la jeune femme, qui se plie de bonne grâce au service du thé, ainsi qu'à son devoir, plus implicite, d'être décorative. A chaque âge de la vie d'une femme son rôle et ses devoirs : la maturité offre l'avantage d'une respectabilité accrûe, d'un surplus d'autorité, mais exige en retour un comportement digne jusqu'à l'asutérité ; la jeunesse souscrit à des obligations de séduction, d'élégance, mais se doit aussi d'adopter un maintien docile et modeste.Ce rituel du thé forge ainsi l'occasion d'un cérémonial fédérateur, garant d'entente, d'ordre et de tradition.


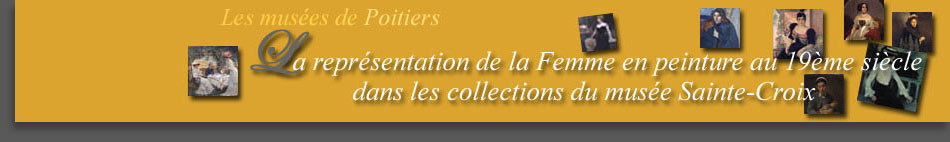




 Quoi en penser ? Ce petit portrait de groupe permet à chacun d'assumer ses responsabilités d'ordre familial : l'effacement pour le viel homme et le garçonnet, unis dans le même mouvement d'affection, et qui reconnaissent par leur retrait que les femmes règnent en maîtresse dans l'aire domestique ; l'allure irréprochable pour la femme assise - mère ou belle-mère ayant gagné avec le temps un statut influent ; l'attitude respectueuse pour la jeune femme, qui se plie de bonne grâce au service du thé, ainsi qu'à son devoir, plus implicite, d'être décorative. A chaque âge de la vie d'une femme son rôle et ses devoirs : la maturité offre l'avantage d'une respectabilité accrûe, d'un surplus d'autorité, mais exige en retour un comportement digne jusqu'à l'asutérité ; la jeunesse souscrit à des obligations de séduction, d'élégance, mais se doit aussi d'adopter un maintien docile et modeste.Ce rituel du thé forge ainsi l'occasion d'un cérémonial fédérateur, garant d'entente, d'ordre et de tradition.
Quoi en penser ? Ce petit portrait de groupe permet à chacun d'assumer ses responsabilités d'ordre familial : l'effacement pour le viel homme et le garçonnet, unis dans le même mouvement d'affection, et qui reconnaissent par leur retrait que les femmes règnent en maîtresse dans l'aire domestique ; l'allure irréprochable pour la femme assise - mère ou belle-mère ayant gagné avec le temps un statut influent ; l'attitude respectueuse pour la jeune femme, qui se plie de bonne grâce au service du thé, ainsi qu'à son devoir, plus implicite, d'être décorative. A chaque âge de la vie d'une femme son rôle et ses devoirs : la maturité offre l'avantage d'une respectabilité accrûe, d'un surplus d'autorité, mais exige en retour un comportement digne jusqu'à l'asutérité ; la jeunesse souscrit à des obligations de séduction, d'élégance, mais se doit aussi d'adopter un maintien docile et modeste.Ce rituel du thé forge ainsi l'occasion d'un cérémonial fédérateur, garant d'entente, d'ordre et de tradition.